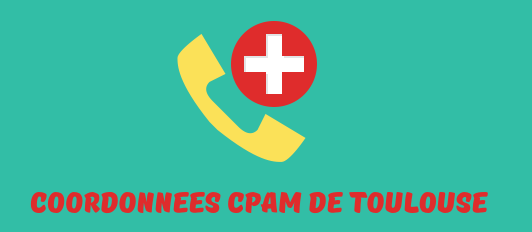De la même façon que le mariage, le baptême est une fête étroitement liée aux traditions religieuses, mais qui peut aussi s’inscrire dans un cadre totalement laïc. Si vous n’êtes pas croyant ou pratiquant, vous vous interrogez peut-être sur l’intérêt de faire baptiser votre enfant.
Il y a par exemple des familles dans lesquelles le baptême se réalise de façon automatique, comme une manière de fêter l’arrivée de l’enfant. Certains couples peuvent aussi être confrontés à la question si les deux partenaires ne partagent pas la même religion. Vous êtes alors en droit de vous questionner : quelles sont les valeurs transmises par cet acte, et sont-elles compatibles avec les vôtres ?
Le baptême laïc, une alternative de plus en plus prisée
À première vue, le mot « baptême » évoque spontanément l’église, les rites religieux, et une dimension spirituelle. Pourtant, il existe aujourd’hui une autre manière de célébrer l’arrivée d’un enfant : le baptême civil, aussi appelé baptême républicain. Né à la Révolution française, ce rituel laïc a été pensé comme une réponse à ceux qui souhaitaient marquer symboliquement la naissance d’un enfant sans passer par la case religion.
Concrètement, le baptême civil se déroule à la mairie, souvent dans la salle des mariages, en présence de la famille, des amis, et bien sûr des parrains et marraines choisis pour accompagner l’enfant sur son chemin de vie. Ici, pas de bénédiction ni de sacrement. Il s’agit avant tout d’un engagement moral, d’une promesse de soutien et de protection, mais sans implication religieuse.
Ce type de cérémonie séduit de plus en plus de parents qui souhaitent donner une dimension festive et solennelle à la venue de leur enfant, tout en restant fidèles à leurs convictions personnelles. C’est aussi l’occasion de transmettre des valeurs citoyennes et républicaines, comme la solidarité, la tolérance ou le respect de l’autre, qui peuvent résonner tout autant – voire plus – que des valeurs religieuses pour certains d’entre nous.
Pourquoi des parents athées choisissent-ils le baptême civil ?
Quand on ne croit pas ou qu’on ne pratique pas, la question du baptême peut sembler superflue, voire contradictoire. Pourtant, de nombreux parents athées font le choix d’organiser un baptême civil pour leur enfant, et ce n’est pas simplement pour « faire comme tout le monde ».
Il y a d’abord ce besoin très humain de marquer les grandes étapes de la vie. L’arrivée d’un enfant, c’est un bouleversement, une joie immense, et beaucoup ressentent l’envie de célébrer ce moment entourés de leurs proches. Le baptême civil offre alors un cadre officiel et festif, sans connotation religieuse, pour accueillir l’enfant dans la famille et la société.
Il y a aussi la question des parrains et marraines. Même en dehors de toute croyance, beaucoup tiennent à désigner des personnes de confiance qui joueront un rôle particulier auprès de leur enfant. Le baptême civil permet de formaliser cet engagement moral, de donner du sens à ce lien, sans pour autant lui accorder une portée religieuse ou légale. C’est alors l’occasion pour la marraine et le parrain d’offrir à leur filleule une médaille de baptême pour fille, ou de choisir ensemble une belle gourmette en or pour leur filleul.
Pour certains, le baptême civil est aussi une façon de transmettre des valeurs qui leur tiennent à cœur : ouverture d’esprit, tolérance, respect des différences, attachement à la laïcité. Le baptême civil devient alors un symbole fort, celui d’un engagement envers l’enfant et la société, dans le respect des convictions de chacun.
Mais avant tout, choisir le baptême civil, c’est un moyen de laisser l’enfant libre de ses choix futurs. On lui offre une cérémonie, une fête, mais sans lui imposer une appartenance religieuse. Plus tard, il pourra décider par lui-même du chemin qu’il souhaite suivre.
Quand les convictions diffèrent dans le couple
La question du baptême prend parfois une tournure plus délicate lorsque les deux parents n’ont pas les mêmes convictions. Il n’est pas rare qu’au sein d’un couple, l’un soit attaché à une tradition religieuse, tandis que l’autre s’en sente éloigné, voire s’en méfie un peu. Dans ce contexte, le baptême – qu’il soit religieux ou civil – devient un sujet de discussion, parfois même de négociation.
Pour certains couples, le baptême civil apparaît alors comme une solution de compromis. Il permet d’organiser une cérémonie symbolique, de réunir la famille autour de l’enfant, sans pour autant imposer une démarche religieuse à celui ou celle qui n’y adhère pas. Chacun y trouve une forme de reconnaissance. Le parent croyant peut y voir un geste d’engagement envers l’enfant, tandis que le parent athée y retrouve des valeurs de laïcité et de respect des différences.
Il arrive aussi que des familles choisissent de cumuler les deux cérémonies : un baptême religieux pour satisfaire les traditions et la foi d’une partie de la famille, et un baptême civil pour affirmer l’attachement à la République et à la neutralité spirituelle. Cela permet de rassembler tout le monde, de respecter les sensibilités de chacun, et d’offrir à l’enfant une double ouverture sur le monde.
Au fond, l’essentiel reste le dialogue. Il permet de prendre le temps d’échanger, d’écouter les attentes et les craintes de l’autre, et de trouver ensemble la formule qui a du sens pour votre famille. Le baptême, qu’il soit civil ou religieux, n’est jamais une obligation – mais il peut devenir un joli moment de partage, à condition qu’il soit choisi en conscience et en accord avec vos valeurs communes.
Le baptême comme rite culturel et familial
Au-delà des convictions religieuses ou philosophiques, le baptême reste pour beaucoup une tradition familiale, presque un passage obligé, qui dépasse le simple cadre de la foi. Dans certaines familles, on baptise les enfants « parce que ça se fait », parce que c’est l’occasion de rassembler les proches, de présenter le nouveau-né à la communauté, ou tout simplement de perpétuer une coutume qui traverse les générations.
Dans ce contexte, le baptême – qu’il soit civil ou religieux – prend une dimension essentiellement culturelle. Il devient un prétexte à la fête, à la transmission de souvenirs et d’histoires familiales, à la création de liens entre les différentes branches de la famille. On se souvient du baptême de ses cousins, de la robe de famille portée par plusieurs générations, ou encore du repas partagé après la cérémonie. Ce sont ces moments qui restent, bien plus que la signification religieuse du rituel.
Pour les parents athées, le baptême civil offre justement la possibilité de préserver cet aspect festif et rassembleur, sans pour autant renier leurs convictions. On peut ainsi organiser une belle cérémonie, choisir des parrains et marraines, faire la fête… tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa vision du monde. C’est aussi une manière de donner du sens à la fête, de la personnaliser, d’y intégrer des lectures, des musiques ou des discours qui parlent vraiment à votre famille.
Finalement, qu’on le voie comme un rite de passage, un moment de partage ou une simple tradition, le baptême – sous toutes ses formes – permet de célébrer l’arrivée d’un enfant et de lui souhaiter la bienvenue dans la vie, à sa façon. Et c’est peut-être là l’essentiel.